La honte sociale : une histoire française ?

Enfants des classes populaires, ils ont fait de longues études ou ont bénéficié d’une ascension sociale : tous ont le point commun d’être des transfuges de classe. Mais pour trouver sa place, est-on obligé de trahir son milieu d’origine ? Et sinon, pourquoi ces transfuges sont-ils souvent renvoyés à un sentiment de honte sociale ou de trahison ? Décryptage.


Maëlle Boivison a tout d'une gagnante. À 23 ans, elle prépare cette année le concours de l’École Nationale d’Administration (ENA), une période stimulante, qui réveille aussi chez elle d'importants questionnements identitaires. Fille d’un maçon et d’une maroquinière, Maëlle ne s’est « jamais autant sentie à [sa] place qu’en préparant l’ENA ». Mais depuis le début de ses études, et encore plus cette année, la future fonctionnaire s’est mécaniquement éloignée de ses parents : « Je ne sais pas vraiment comment leur expliquer ce que je fais », regrette-t-elle. Ses proches sont très fiers mais se montrent peu démonstratifs, surtout son père : « Depuis que je prépare l’ENA, il est souvent opposé à mes idées et se montre plus distrait et agressif, ce qui nous empêche de vraiment discuter, donc j’ai appris à m’effacer pour profiter des bons moments ».
La conquête d’une identité
Maëlle est une « transfuge de classe », un nom savant pour désigner ceux qui ont gravi l'échelle sociale. Et ils sont encore des exceptions : bien que la mobilité sociale continue de croître sur le long-terme, sa progression est fortement ralentie depuis les années 1980. Alors en raison de son statut, Maëlle se questionne sur sa « double affiliation sociale ». Un sentiment qu'explique le sociologue Jules Naudet : « Pour être intégré dans un nouveau milieu, il faut parfois affronter les remarques des proches qui vous accusent de vous détourner d’eux ; il faut composer avec cette culpabilité morale d’avoir trahi. Et puis on en vient à se surprendre d’avoir honte des siens, et ensuite à « avoir honte d’avoir honte ».
Évolution de la mobilité sociale des fils d'employés ou d'ouvriers non qualifiés entre 1977 et 2015 (en pourcentage)
Lecture : En 2015, 8% des fils d'ouvriers ou employés non qualifiés sont devenus cadres
ou exercent une profession intellectuelle supérieure
Cette peur de la trahison est plus fréquente en France, puisque selon l’enquête comparative de Jules Naudet dans son ouvrage Entrer dans l’élite, les Français en mobilité sociale disent davantage avoir « le sentiment de n’appartenir ni à une classe ni à une autre », comme si la vie d’avant et la vie d’après n’étaient pas compatibles. Contrairement aux Américains qui, par exemple, auraient tendance à minimiser les différences entre les deux milieux sociaux.
C’est aussi le cas de Sophie, une enseignante de français de 37 ans, passée par l’École Normale Supérieure (ENS) à Lyon. Les premiers jours sur les bancs de cette institution ont toujours la même saveur, celle de « la plus grosse claque sociale » de sa vie : le sentiment d’illégitimité d’abord, et puis un long travail pour s’adapter aux codes des « fils de ». Aujourd’hui, les souvenirs des belles amitiés nouées à l’ENS se mêlent à la sensation, encore fraîche, de « ne pas avoir été à [sa] place ».
Une fois diplômée, l’Éducation Nationale l'installe finalement dans un petit collège de Bourgogne. De retour dans un milieu social plus proche de ses origines, le stigmate s’inverse : « Quand je suis arrivée au début, mes collègues me demandaient ce que je faisais là. L’air de dire : nous on est des bouseux car on enseigne au collège, donc tu n’as rien à faire ici. Après, ça c’est amélioré évidemment. Mais j’étais encore une fois à une place qui n’était pas la mienne ».
La rigidité des frontières de classe
Ne pas trouver sa place. Un discours qui s'explique surtout par le fait que « les distinctions de classe sont plus anciennement et solidement intériorisées et installées en France », analyse le sociologue Camille François. Autrement dit, la richesse ne fait pas le riche. Et d'ajouter : « Il est plus facile de se sentir bourgeois aux États-Unis, où la bourgeoisie est récente et centrée autour du capital économique, plutôt qu’en France, où la bourgeoisie, plus ancienne, s’accompagne aussi de quartiers de noblesses culturelles » (voir la vidéo ci-dessous).
Vidéo : Une très brève histoire des classes sociales en France
Pierre, qui est pourtant très bien intégré dans son milieu professionnel depuis vingt ans, connaît bien ce problème. Père de famille de 52 ans, il est né à Toulouse d'une mère lingère, et est devenu ingénieur, puis consultant pour des entreprises pétrolières en gravissant progressivement les échelons. Il se souvient notamment d'une soirée entre amis : « Un chercheur au CNRS m'a demandé par quelle école j'étais passé. Moi, j’ai menti, j’ai dit que je sortais d'une école d’ingénieur à Toulouse, alors que je n'en ai pas fait. Il a fouillé la liste des diplômés, et évidemment il ne m’a pas trouvé, donc il a demandé à ma femme si c’était vrai. Je me suis senti humilié, comme si j’étais un usurpateur ». Une expérience qui a renforcé un temps son sentiment d'illégitimité.
Chez Sarra, fille d'ouvriers toulousains devenue commerciale à 28 ans, c'est surtout le rapport à l'argent qui évoque la peur de la trahison : « Les études m'ont permis d’avoir un meilleur salaire mais ça me rend mal, car je sais qu'à moi seule, je gagne ce qu'ils n'ont jamais touché à deux. Si mes parents avaient eu la chance de faire des études, ils auraient réussi aussi. Alors je me devais de réussir, c'était un peu nos études à nous ».
PHOTOS DE FAMILLE DE PIERRE AVEC SES FILS ET SA MÈRE (ROUGE), MAËLLE AVEC SES PARENTS (BLEU)
ET SARRA AVEC SES PARENTS ET FRÈRES ET SOEURS (JAUNE)
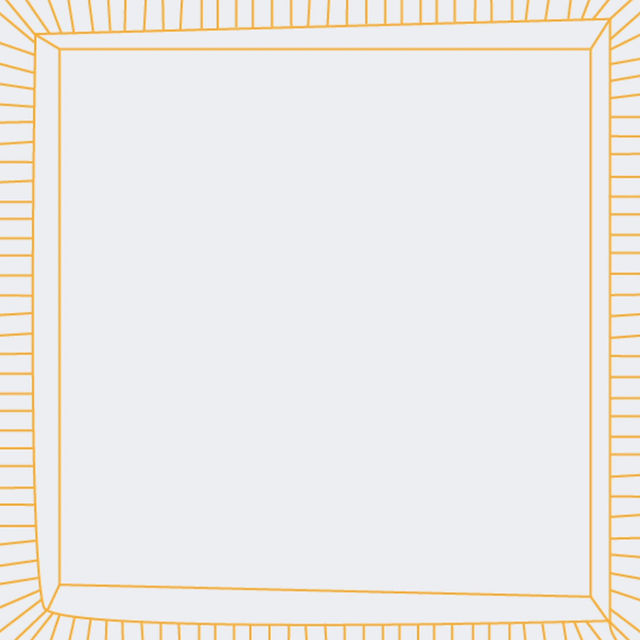

La trahison, une construction
On pourrait s’étonner de la persistance de ces discours sur la peur de trahir, à une époque où la réussite scolaire est très valorisée par l’idéal méritocratique. Et pourtant, ceux-ci restent centraux. On pense évidemment à l’œuvre de la romancière française Annie Ernaux, dont l'ouvrage La Place raconte son histoire, celle d’une intellectuelle en rupture avec son milieu ouvrier d’origine. Ce mal-être est également raconté par le sociologue Didier Eribon dans Retour à Reims, ou plus récemment par l'écrivain Édouard Louis, qui narrent tous deux leur fuite du milieu ouvrier pour étudier à Paris.
L'analyse en termes de trahison n'est pas totalement fausse, rappelle le sociologue Camille Peugny, spécialiste de la mobilité sociale : « Dans beaucoup de récits, on trouve une relation ambivalente entre le milieu social d’origine et d’arrivée. Mais il faut analyser ces tensions en des termes sociologiques, donc de normes et de valeurs, et pas seulement en des termes psychologiques ».
Et pourtant, c’est par là qu’a souvent débuté l’analyse des transfuges de classe. À commencer par le terme de « transfuge », qui dans le vocabulaire guerrier, renvoie à une « personne qui abandonne son armée, son pays pour passer à l'ennemi ». À ce terme, la philosophe Chantal Jaquet a d’ailleurs préféré pour ces raisons le mot « transclasse » dans son ouvrage Les transclasses ou la non-reproduction.
Mais au-delà du lexique, « l'immense majorité des travaux de sociologie sur les transfuges sont focalisés sur les situations de clivage du moi et de sentiment de culpabilité. Il y a tout un registre pathologique mobilisé pour décrire l'expérience de la mobilité sociale », résume Camille François. Le sociologue fait notamment référence au concept de « névrose de classe », forcé par Vincent de Gaulejac, ou à l'« habitus clivé » de Pierre Bourdieu, désignant tous deux un état de tension psychologique résultant de la promotion sociale.
Pour comprendre l’émergence de ce vocable, retour dans les années 1920 et 1930, aux États-Unis. C’est là-bas qu’est fondée la discipline de la mobilité sociale, et à l'époque, la sociologie américaine est « assez proche de la psychologie et de la littérature médicale ». L’inventeur du concept de mobilité sociale, Pitirim Sorokin, met d’ailleurs en garde contre la perte de repères engendrée par le changement de classe.
Proche de la psychologie, mais aussi de la littérature. À la fin du XIXe siècle, la fondation de la sociologie a lieu en pleine apogée des romans réalistes, notamment portés par Honoré de Balzac. « La sociologie est héritière d’un schème littéraire, où on décrit la mobilité sociale sous deux traits principaux : celui de l’ambition et de l'arrivisme ; ou d’une mobilité malheureuse menant au bannissement de la classe sociale d'origine et d'arrivée », précise Camille François. Rien que dans l’œuvre de Balzac, on retrouve ces deux caractéristiques sous la forme de l’arriviste Rastignac, dans Le Père Goriot et La Comédie humaine ; ou du malheureux Lucien de Rubempré, dans Les Illusions perdues.
Alors pourquoi ce discours a-t-il encore autant de force aujourd’hui ? Pour la sociologue Marie Duru-Bellat, spécialiste des inégalités scolaires, « les transfuges de classe ont bénéficié de la méritocratie (l'idée que l'on réussit grâce à ses efforts individuels, ndlr), mais les études les rendent aussi conscients des inégalités. Je pense que l'intériorisation de la méritocratie par ces personnes peut aussi créer des tensions identitaires ».
L’adaptation
Plutôt qu'un sentiment de trahison, les transfuges de classe parlent plus souvent de culpabilité. Une culpabilité qui peut aussi être une manière de se rapprocher de son milieu d'origine ou de lui rendre hommage. Sarra par exemple, se sent en devoir de donner cent euros par mois à ses parents depuis qu'elle touche un salaire : « Parfois, quand je vais m’acheter une tenue, je culpabilise. Je me dis qu’ils ont raqué toute leur vie pour me faire plaisir, donc je veux qu’ils soient sur le même pied d’égalité que moi ». Après plus de cinq années passées à les aider à distance, elle vient d'ailleurs de quitter Paris pour les rejoindre à Toulouse.
Chez Pierre, qui a aussi épaulé sa mère toute sa vie, l'attachement au milieu d’origine se traduit surtout par des « valeurs de gauche ». « À une époque, quand je voyais tout cet argent débouler sur mon compte à la fin du mois, j’avais un sentiment d'imposture ». Pour atténuer cette contradiction, Pierre reste très engagé politiquement et soutient les « gens comme lui » dès qu’il en a l’occasion. Notamment ce « mec brillant » qu’il a nommé à sa succession en Indonésie, alors qu’il n’avait aucun diplôme. Une manière concrète de renvoyer l'ascenseur.
Car si « la richesse ne fait pas le riche », Pierre en est persuadé : on ne quitte jamais vraiment sa classe sociale. « On reste marqué au fer rouge. J’en ai avalé des couleuvres pour dire que j'étais intégré mais je sais que ce n’est toujours que temporaire. Je ne renierai jamais d’où je viens ».
Sophie est sur la même longueur d'onde : « J'ai bénéficié de l'ascenseur social à un moment donné, mais je pense qu’on ne change jamais vraiment de classe ». L'enseignante se sent aujourd'hui « rejetée » par l'Éducation Nationale, qui ne lui a pas ouvert la voie de la recherche, malgré son passage à l'ENS. « Je n'ai jamais appris à réseauter, et ça m'a coûté un poste en faculté ».
Aujourd'hui, Sophie et Pierre n'ont plus aucun problème à se définir comme des personnes « duelles ». À 37 et 52 ans, la culpabilité se fait plus rare que dans la bouche des vingtenaires Sarra et Maëlle, qui commencent à peine leur vie professionnelle. Plus qu'un sentiment de trahison, c'est surtout la culpabilité et des questionnements identitaires qui les animent. Mais l'objectif reste toujours le même : non pas celui de trouver sa place, mais d'en créer une sur-mesure, avec ses propres règles.
Un article de Lucile Meunier, étudiante à l'école de journalisme de Sciences Po
Un grand merci à Romain Lagrange, qui m'a aidée à réaliser l'identité visuelle.
